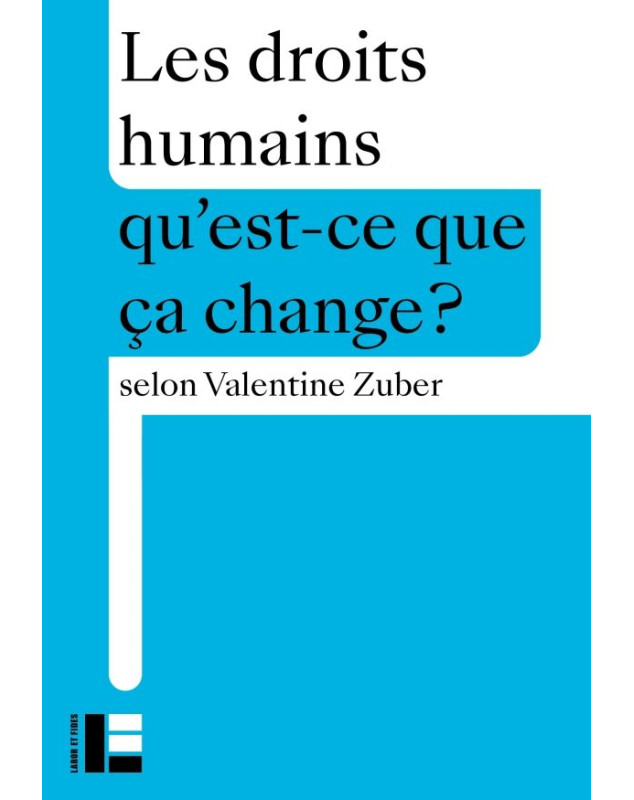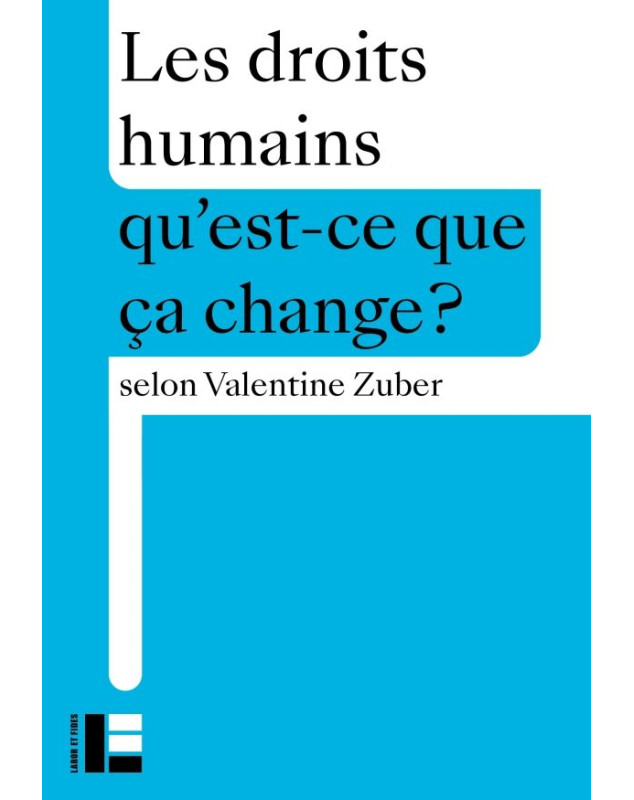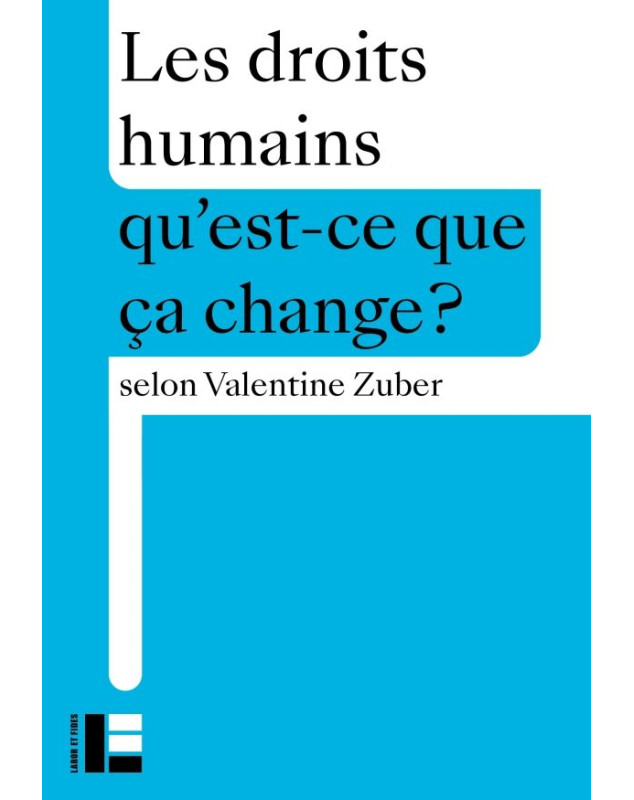Le monde tel que nous le connaissons ne serait pas le même sans l’avènement, à la fin du XVIIIe siècle, de ce qu’on appelle communément les « droits de l’homme ». Credo moderne des droits et des libertés fondamentales, ils se sont traduits par l’élaboration d’une importante législation internationale obligeant les États à les faire respecter. Mais chaque crise géopolitique en relance à la fois la pertinence et les limites.
Tissés d’histoire et de philosophie, les droits de l’homme sont à la fois un guide vers plus de justice au niveau planétaire et un point de butée de l’universalisme. Valentine Zuber, titulaire de la chaire « Religions et relations internationales » de l’École pratique des hautes études, nous aide à penser ce que cette philosophie politique à visée universelle peut encore nous apporter aujourd’hui et quels défis il lui reste à relever pour qu’elle soit réellement appliquée.
L'autrice :
Valentine Zuber est historienne, directrice d’études à l’École pratique des hautes études à Paris. Elle a publié entre autres : "Idées reçues sur la laïcité" (Le Cavalier bleu, 2017), "Le culte des droits de l’homme" (Gallimard, 2014) et, avec Jean Baubérot, "Une haine oubliée. L’antiprotestantisme avant le pacte laïque (1870-1905)" (Albin Michel, 2000, Prix Eugène Colas de l’Académie française).
L'avis du libraire :
Dans ce petit essai pertinent, Valentine Zuber interroge la portée des droits humains — nés à la fin du XVIIIᵉ siècle — en tant que boussole philosophique et juridique, tout en en soulignant les paradoxes et les limites quand il s’agit de les appliquer aux crises contemporaines. En mêlant histoire, philosophie et enjeux géopolitiques, elle examine ce que cette visée universaliste peut encore légitimement apporter aujourd’hui et les défis qu’elle doit encore surmonter.
La collection Qu’est-ce que ça change ?, publiée par Labor et Fides, se compose de petits essais poignants (environ 96 pages chacun) qui explorent, à travers divers concepts fondamentaux (comme l’origine, la vie, la promesse, le cerveau, ou la mémoire), les transformations engendrées par ces notions dans notre pensée et notre existence.