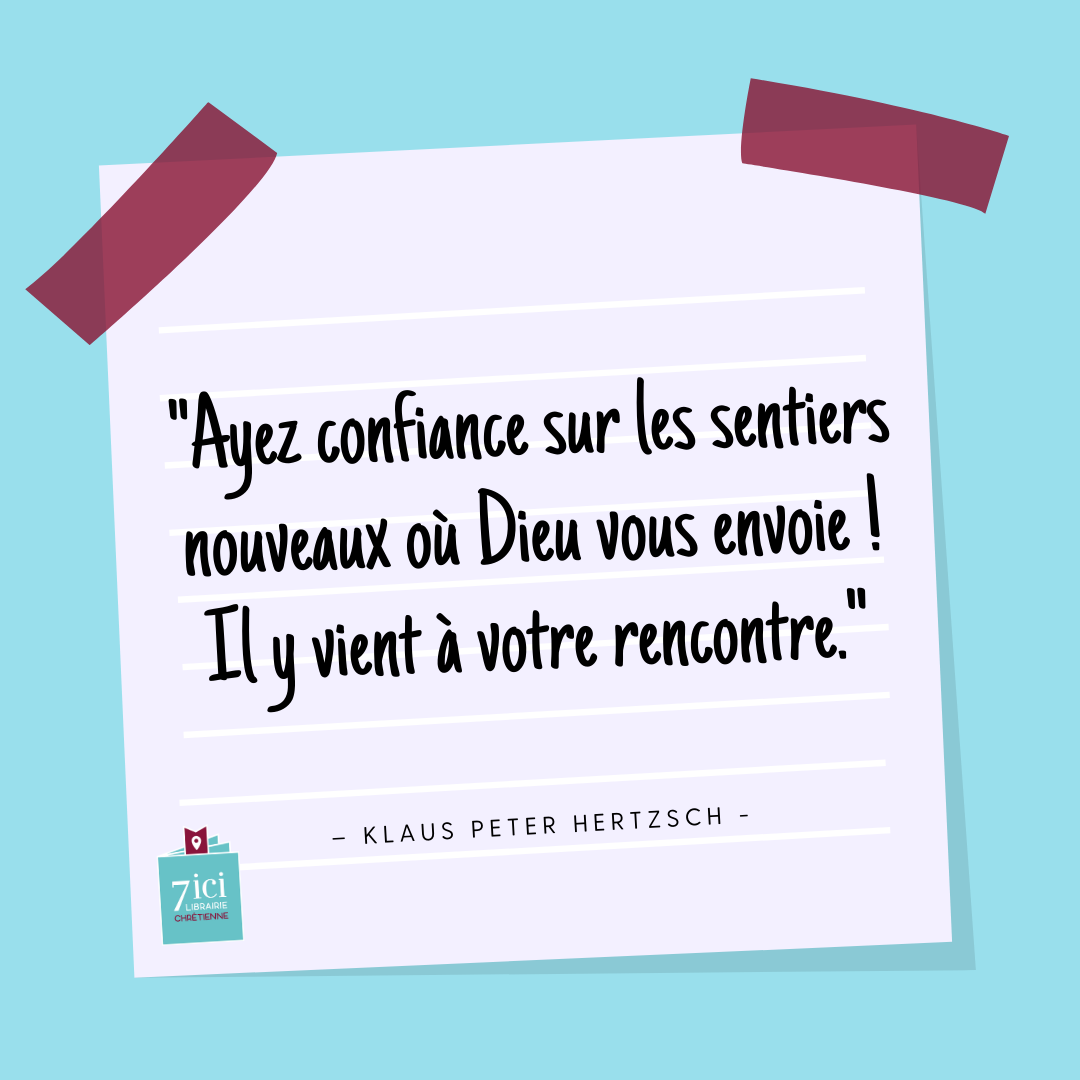L’Eglise face à la guerre et à la violence,
Notre auteur (désormais mentionné par les initiales N.B.), est professeur d’histoire à la FLTE, de confession mennonite ce qui explique aussi l’intérêt qu’il porte à cette thématique du positionnement des églises par rapport à la guerre et à la violence. Ce livre s’inscrit dans la collection « Perspectives anabaptistes » aux éditions Excelsis.
L’Evangile comme récit de paix. L’Eglise face à la guerre et à la violence,
Neal Blough, Excelsis, 2025, 283 p. 18 €
Dans la première partie, N.B. pose les principes d’une grille d’interprétation narrative des textes bibliques – surtout les textes de genre littéraire historique de l’A.T. La forme du texte biblique est avant tout celle d’un récit plutôt qu’une suite de propositions doctrinales qu’on pourrait extirper du texte sans tenir compte de l’ensemble de la narration biblique. N.B. pense que les concepts théologiques peuvent réguler les éventuels dérapages d’une interprétation narrative et inversement, le récit est là pour ne pas absolutiser les concepts théologiques. La cohérence des récits bibliques se trouve dans les textes d’Eph 1, 9-10 et Col 1, 19-20 qui décrivent le dessein de Dieu de tout réconcilier avec lui-même et c’est à l’aune de ce dessein qu’il faut lire ces récits.
2 remarques sur cette première partie :
- p 24-25 : La compréhension du péché et de l’origine du mal : N.B. ne parle pas de la précédence du tentateur (le serpent) dans sa lecture de Gen 3 mais insiste uniquement sur la responsabilité humaine du mal dans les relations humaines.

Neal Blough
- p. 72 : N.B. nous met en garde, à juste titre, contre une lecture qui utiliserait le livre de l’Apocalypse pour justifier la violence. Cependant, sa lecture du jugement de Dieu en Apoc 19, 11 donne à penser que ce n’est pas un jugement direct de Dieu mais que cette violence divine décrite dans ce passage (l’épée dans la bouche du Christ) est représentée « symboliquement » par « l’exclusion finale de tout ce qui refuse d’être racheté par l’amour souffrant de Dieu ».
Concernant cette partie, j’ai trouvé le chapitre 3 fort pertinent pour une lecture renouvelée de l’histoire de l’Eglise notamment l’incorporation de la culture violente des religions germaniques qui a influencé le processus de christianisation de l’Europe médiévale. Processus que N.B. décrit comme « la germanisation magico-religieuse de l’Eglise occidentale » (pp. 84ss). Processus qui a perduré sous différentes formes tout au long de l’histoire de l’Eglise. Dans ce processus d’acculturation N.B. se demande si ce n’est pas tant une paganisation du christianisme qu’une christianisation du paganisme. Pour ce chapitre, N.B. s’est largement inspiré des travaux de l’historien James C. Russell. N.B. déduit de cette politique d’acculturation que « La guerre avait une valeur éthique supérieure à la paix » p. 89. Ce processus de justification de la violence va favoriser la mise en place du système féodal, le rôle des chevaliers et leur culture de la bravoure et de la guerre, la centralisation du pouvoir papal qui aboutira à la justification théologique de la violence par les croisades. Ce processus va perdurer dans la chrétienté européenne confrontée à la civilisation musulmane, puis à celle de l’Afrique et enfin à celle du nouveau monde.
4 remarques sur ce chapitre :
- pp. 106-107 : N.B. pense que le rejet du christianisme en Europe aujourd’hui est en partie dû à cette histoire belliqueuse de l’Eglise. Cet argument est délicat pour plusieurs raisons : d’abord qu’entendons-nous par « christianisme » et « Eglise » ; d’autre part comment prouver que ce soit uniquement des facteurs religieux qui ont prévalu dans ces guerres dites religieuses. Le péché ne dispose-t-il pas de grandes ressources argumentaires pour justifier les pires exactions et pas seulement ces contrefaçons religieuses ?
- pp. 107-108 : plus on serait convaincu de son idée plus on deviendrait violent en stigmatisant l’autre (cet argument est aussi utilisé par les athéistes militants pour décrier les religions monothéistes, les autres religions étant par définition plus tolérantes) : « Le contexte politique international tend à renforcer l’idée qu’une idée forte religieuse est automatiquement source de conflit ou de violence » (c’est nous qui soulignons). Cet argument peut aussi se retourner à l’inverse on voit bien que ce qui maintient les chrétiens en état de résistance dans des pays persécuteurs c’est justement leur force de conviction. Le danger étant plutôt dans la collusion entre pouvoir politique et institution religieuse, ou bien dans le mélange des genres nationalisme-religion.
- J’ai trouvé que N.B. ne donnait pas assez le change, dans cette lecture de l’histoire de l’Eglise, aux historiens médiévistes (D. Barthélémy, J. Heers, A. Vauchez, G. Duby voir aussi « Des chrétiens contre les croisades » de M. Aurell) qui ont relevé tous les aspects positifs et civilisateurs de cette Eglise de chrétienté notamment par les mesures, certes parfois coercitives, des paix diocésaines, des trêves de Dieu pour protéger justement les populations pauvres et sans protection et pour endiguer la violence des Seigneurs. Il est vrai que pages 139 à 140 N.B. précise que si l’on doit écrire une théologie du contre-témoignage de l’Eglise celle-ci devrait être « une théologie qui opère une relecture du récit de l’histoire de l’Eglise afin d’en mesurer les cohérences profondes et les incohérences par rapport à l’œuvre rédemptrice de Dieu en Jésus-Christ… » (c’est nous qui soulignons).
- Enfin, une remarque plus générale de théologie fondamentale : si l’on suit l’analyse pessimiste sur l’histoire du christianisme, quid de la providence de Dieu et de sa souveraineté ? Comment expliquer une telle durée et longévité de ce christianisme de chrétienté qui serait un contre témoignage au regard de l’histoire humaine ? Quoi qu’il en soit, la question mériterait d’être posée.
La deuxième partie : quelle Eglise ? Quelle est sa place dans le monde ? Ce chapitre nous parle d’éthique de convictions. Comment vivre à la suite du Christ l’Evangile dans un monde violent qui prône le relativisme en éthique et le pragmatisme en politique et relations internationales. N.B. pense que la dimension communautaire est fondamentale pour pratiquer et démontrer en qui consiste une éthique de la croix. Les convictions ne peuvent rester dans le privé de nos consciences car alors elles n’auront aucun impact dans nos sociétés et nos modes de vie sécularisés : « Si les convictions théologiques ne sont que privées, comment peuvent-elles avoir une pertinence quelconque dans l’espace public ? » (p. 113, à noter que la notion « d’espace public » est très difficile du point de vue sociologique et politique à déterminer, on le voit dans tous les débats sur la laïcité en France).
Dans cette partie N.B. affirme des convictions anthropologiques et ecclésiales très fortes : « La réalité communautaire et ecclésiale précède la réalité individuelle, de même que la réalité familiale et culturelle précède nos identités individuelles » (p. 131). Ici N.B. s’appuie sur les travaux de M. Fassier (« L’Eglise comme communauté narrative ») et S. Hauerwas (« Le royaume de paix » ; « Etrangers dans la cité »).
La troisième partie : La pertinence de la non-violence dans le témoignage de l’Eglise. Dans ce chapitre N.B. modère, atténue certaines positions du pacifisme (p. 226). Il en appelle à penser l’Eglise comme un contre-pouvoir mais en luttant avec les armes spirituelles et en redéfinissant de façon radicale la notion de pouvoir « le pouvoir dans la faiblesse, le pouvoir par l’humble service… par le don de soi » (p. 214). Ce n’est qu’ainsi que l’Eglise rentrera dans la résistance au mal collectif. Ici on entend comme des échos de la prédication du pasteur réformé du Chambon/Lignon A. Trocmé le 23 juin 1940 au lendemain de l’armistice. Il avait prononcé ces mots face à la montée de l’idéologie nazi et au lendemain de l’armistice : « Le devoir des chrétiens est d’opposer à la violence exercée sur leur conscience les armes de l’Esprit. ». Comment faire face à la violence autrement qu’en y opposant sa propre violence ? En passant de la non-résistance passive à la non-violence active, autrement dit en ne recherchant pas seulement l’absence de conflits armés mais en préparant, formant les personnes à défendre de justes causes, en délégitimant la guerre conçue comme moyen de résoudre les conflits, en promouvant la justice à tous les niveaux : politique, institutions, associations etc…
Un point du chapitre 7 de cette dernière partie mérite d’être mentionné : la dénonciation de la réalpolitique qui consiste à justifier la guerre sous couvert de « nécessité » ou de « responsabilité ». N.B. analyse finement cette question en soulignant que « les notions de réalisme et de responsabilité sont aussi contingentes, elles sont des constructions de pensée qui peuvent servir tout simplement d’autojustification. » (p. 233)
Une remarque s’impose pour ce chapitre : il y a une ambiguïté dans le traitement des thèses de W. Wink, en effet N.B. semble soutenir certaines de ses thèses et en même temps celles de Marva Dawn qui le contredit (in « Dire la guerre, penser la paix »). Concernant W. Wink, ce dernier ne semble pas accorder de crédit à l’existence des esprits mauvais ou démons dont la Bible se fait l’écho. W. Wink croit que les « puissances et pouvoirs » auxquels nous sommes confrontés dans notre monde postmoderne sont créés et communiqués par des institutions, des structures politico-idéologiques et culturelles. Dans son livre « The powers that be, Theology for a new millenium » W. Wink qualifie la vision du monde spirituel des auteurs du N.T. comme naïve et dépassée. Pour cette raison, il me semble difficile, en tous les cas insuffisant, de suivre cet auteur dans ses conclusions pour discerner quel type de lutte pacifique nous devons préconiser en tant qu’Eglise du Christ.
Une dernière remarque : N.B. affirme p. 49 que « Jésus est mort en raison des réactions historiques, politiques et religieuse à sa manière de vivre et en raison de son refus d’employer certains moyens pour atteindre ses buts ». En complément à cette affirmation, on aurait aimé avoir l’avis de N.B., sur la notion de la croix en tant que châtiment de Dieu et connaitre la/les position(s) anabaptistes sur cette question qui est connexe avec le sujet de la violence et du pacifisme.
Pour conclure : un livre très riche qui analyse la question du pacifisme sous plusieurs angles. Sa dimension historique avec la critique de certaines dérives de l’Eglise dont celle du césaro-papisme, la dimension herméneutique et notre rapport au texte biblique avec des mises en garde pour se défaire de lecture-prétexte à des fins politico-belliqueuses, la dimension éthique avec ce défis de taille : comment vivre l’évangile à la suite du Christ, tout particulièrement le sermon sur la montagne ? Enfin la dimension ecclésiale et la notion de catholicité car pour être porteuse de ce projet de paix l’Eglise doit prendre conscience de sa catholicité pour que son regard dépasse ses propres frontières nationales et culturelles et poser ainsi « un regard critique envers les idéologies qui justifient la violence en temps de guerre » (p. 261). Ce dernier point me semble d’une actualité criante !
Pour celles et ceux qui voudraient avoir aussi un aperçu sur l’histoire contemporaine du pacifisme en Europe, je recommande une série de podcasts sur France-Culture intitulée : Paix une histoire pas si paisible : maudite soit la guerre ! aux origines du pacifisme.
Thierry Rouquet