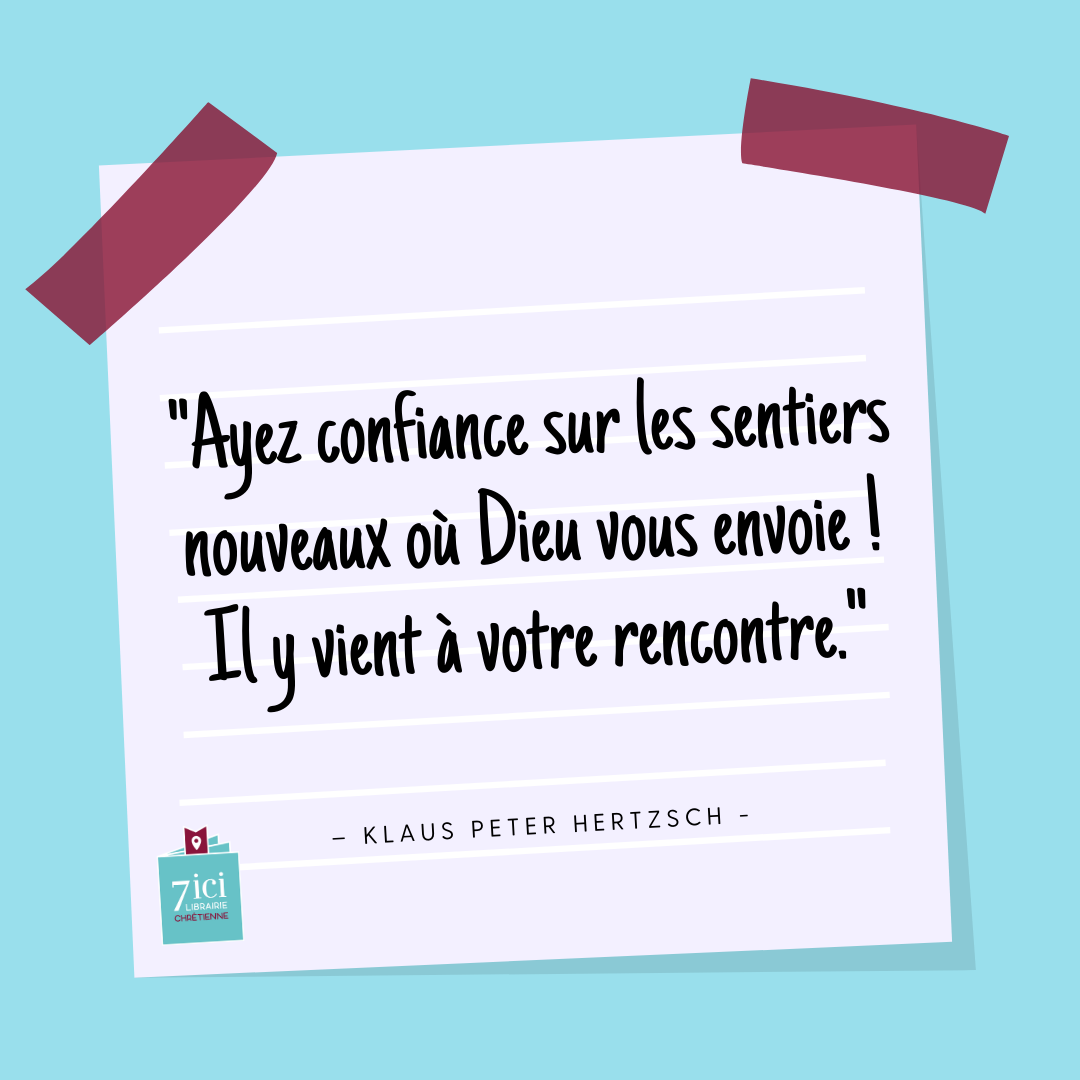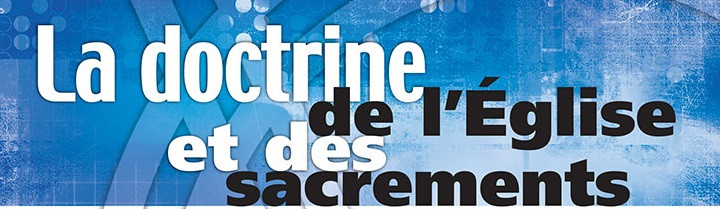
La doctrine de l’Eglise et des sacrements
Voici le tome 2 de l'ecclésiologie d'Henri Blocher (désormais H.B.). Le tome 1 faisait un survol biblique de la conception de l'Eglise dans l'ensemble de la Bible : d'abord dans l'A.T. le peuple de Dieu (Israël) est la communauté de l'alliance en commençant par la vocation d'Abraham jusqu'au dernier prophète avec toutes les inflexions qui vont se développer au cours du temps, puis la communauté messianique dans les textes des évangiles et plus globalement dans l'ensemble du NT jusqu'à la Jérusalem céleste. Ce deuxième tome développe les aspects concrets de l'ecclésiologie : les 2 sacrements commandés par le Christ (baptême et Cène) ainsi que les ministères.
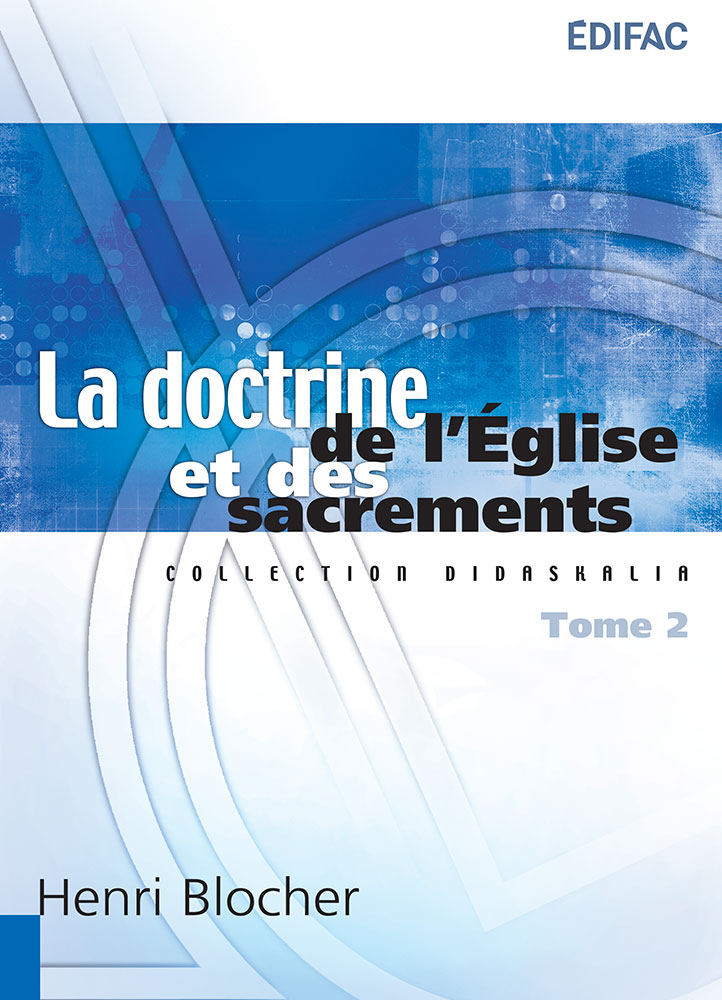
La doctrine de l’Eglise et des sacrements,
Collection didaskalia, Tome 2, Henri Blocher, Edifac, 2024, 361 p. 26 €
Le tome 2 s'ouvre par la partie 3 (car le livre prend la suite du chapitrage du tome 1) et un chapitre général sur les différentes conceptions des sacrements : celle du catholicisme, celle de la position réformée et enfin celle que l'auteur intitule "tierce conception" qui est celle des églises de professants, conception que partage notre auteur et qu'il nomme "baptistique" (p. 73). Chaque position est décrite avec une grande objectivité. Puis viennent les arguments invoqués en faveur de chacune d'elle, enfin quelques considérations critiques. A noter pour chaque position un supplément bibliographique.

Henri Blocher
Les deux chapitres suivants (VI et VII) développent dans le détail le baptême et son administration puis la Cène et sa discipline. A noter des points importants soulevés par l'auteur et qui intéresseront plus grandement les pasteurs, anciens de nos églises : la thèse pédobaptiste de certaines églises évangéliques et la question du rebaptème. Idem pour le chapitre suivant sur la Cène avec les problématiques de l'intercommunion ecclésiale, l'inclusivisme plus ou moins élargi et la discipline en la matière. Enfin, le chapitre VIII vient préciser, s'il était nécessaire, ce qui différencie notre conception de la Cène de celle de l'église catholique intitulé "La Cène, dogme romain et discipline". Ce chapitre important (42 pages) permet de mieux comprendre la théologie sacramentelle au travers d'une introduction historique de l'évolution du dogme romain sur la question de la présence réelle et celle de l'actualisation du sacrifice dans la liturgie de la messe.
La partie 4 développe la théologie des ministères, plus exactement du ministère qui est d'abord celui de l'Eglise, de toute l'Eglise, puis des ministères spécifiques, précisément au chapitre V de cette partie, intitulé "Les principaux ministères officiels" (apôtres, prophètes, docteurs, épiscopes-anciens, diacres). Ici H.B. nous met en garde contre la tentation d'user du terme "apôtre" pour décrire des ministères actuels "Que devient l'apostolat dans le temps?" (pp. 310-312). H.B. note que l'apostolat des 12 est unique, irremplaçable (image du fondement et d'association des 12 à Christ). Par contre, H.B. est ouvert à la possibilité de reconnaitre des apôtres qu'il qualifie de "seconde catégorie" et qui équivaudraient à nos "missionnaires". Quant au ministère d'évangéliste listé dans Eph 4, 11, H.B. reste sceptique : "On ne peut presque rien dire, positivement, qui soit sûr !" (p. 312), ce titre n'étant employé que 2 fois dans le NT pour qualifier des personnes précises. H.B. associe le titre de "docteur" à celui de "pasteur" par le fait qu'il n'y a pas d'article défini entre les deux comme c'est le cas avec les ministères précédents de la liste d'Eph 4, 11. D'autre part, H.B. fait remarquer que le terme "pasteur" est en fait une métaphore employée dans l'AT pour les rois et dans le NT pour ceux qui enseignent "C'est le reflet du rôle directeur de la Parole dans la vie du peuple de la Nouvelle Alliance." (p. 318-319).
Dans cette partie sur la théologie des ministères, H.B. ouvre un dernier chapitre sur une question qui ne fait pas consensus dans le milieu évangélique : "L'accès des femmes aux ministères". Ce chapitre contient un supplément bibliographique fort utile des positions "contre" et "pour", égalitariens contre complémentariens. Ce chapitre s'ouvre sur des considérations anthropologiques : différenciation "essentielle" touchant au sexe mais qui reste une différenciation "seconde" puisque le texte de la genèse souligne aussi l'égale dignité devant Dieu des 2 sexes, puis la différenciation des "rôles". Pour H.B. L'effet de cette dernière différenciation est plus "implicite qu'explicite dans l'Ecriture" (p. 331). Le livre se termine par un index des noms cités.
Conclusion : il manquait un ouvrage évangélique de référence dans le domaine de l'ecclésiologie écrit par un théologien français, avec ces 2 tomes c'est chose faite. On peut remercier H.B. d'avoir utilisé toute son érudition et ses analyses toujours fines pour nous communiquer cette œuvre majeure d'ecclésiologie.
Thierry Rouquet