- Rupture de stock
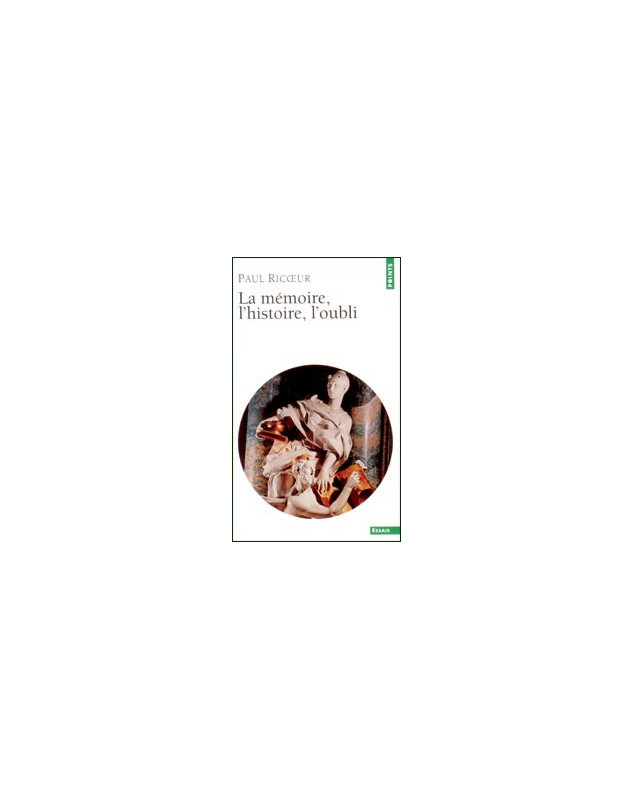
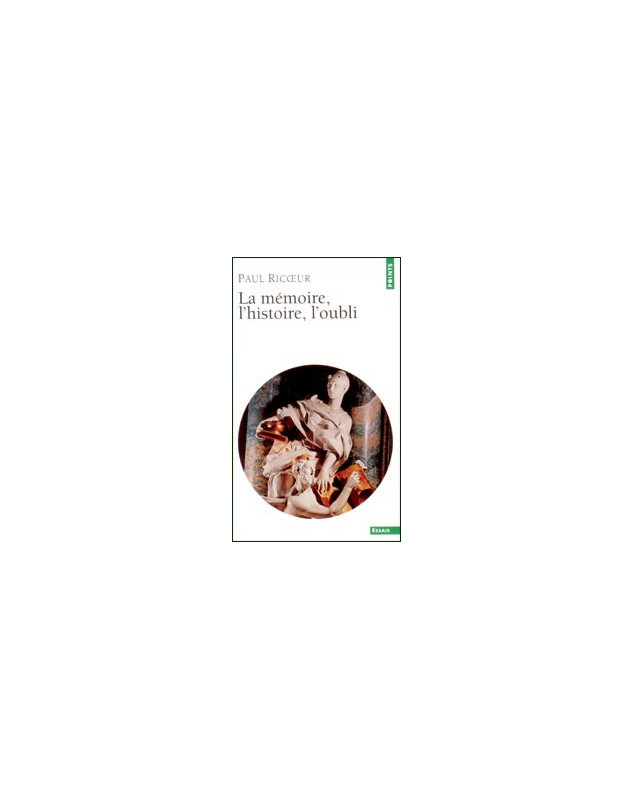
Paul Ricoeur résume ainsi cet ouvrage : il comporte trois parties nettement délimitées par leur thème et leur méthode (...) Une problématique commune court à travers la phénoménologie de la mémoire, l'épistémologie de l'histoire, l'herméneutique de la condition historique : celle de la représentation du passé. L'auteur dit rester troublé par l'inquiétant spectacle que donne trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire - et d'oubli. L'idée d'une politique de la juste mémoire est à cet égard un de ses thèmes civiques avoués.